
Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
 |
|||
 Breizh Bretagne |
|
|
| Lokmaria-Kaer
Locmariaquer |
![]()
| pajenn bet digoret an 31 Meurzh 2015 | page ouverte le 31 mars 2015 | * forum du site Marikavel : Academia Celtica | dernière mise à jour 08/09/2025 21:12:00 |
![]()
| Définition / Displegadur : Commune de la Bretagne historique, en Bro-Wened,
évêché de Vannes. Aujourd'hui dans la région économique non historique dite 'de Bretagne', département du Morbihan; arrondissement de Lorient; canton d'Auray, sur les rivières d'Auray et de Saint-Philibert Code postal : 56740 Superficie : 1099 ha. Population : 2000 'communiants' vers 1780; 2159 hab. en 1886; 2008 hab. en 1891; 1265 hab. en 1968; 1278 hab. en 1982; 1316 hab. en 1996; 1367 hab. en 1999; |
|
![]()
| Armoiries; blason / Ardamezioù; skoed
:
* Froger et Pressensé (1999) : "Coupé : au premier, coupé, au 1 de sinople au dolmen d'argent; au 2, d'hermine; au second, d'azur au navire équipé et flammé d'or" - La commune bretonne particulièrement riche en mégalithes et berceau de nombreux marins" --------- * J.-C. Even : "Troc'het; ouzh ar c'hentañ, troc'het, ouzh 1, en geot e zolmen en arc'hant, ouzh 2, en erminoù; ouzh an eil, en glazur e lest en aour"" |
|
![]()
| Paroisse / Parrez : Notre-Dame / la Vierge / Sainte Marie |
![]()
| Histoire / Istor :
* Ogée (1780) : Locmariaquer; petit port de mer; à 3 lieues 2/3 à 1'O.-S.-O. de Vannes, son évêché; à 24 lieues de Rennes, et à 2 lieues 1/4 d'Auray, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse relève du roi, et compte 2000 communiants. La cure est présentée par l'abbé de Quimperlé. — On prétend que l'ancienne ville de Vannes était où est actuellement Lomariaquer; qu'elle existait plus de six cent cinquante ans avant la naissance de Jésus-Christ, et qu'on la nommait Dariorig. Le président Fauchet rapporte, dans ses recherches sur les antiquités des Gaules, que Sigovèze et Bellovèze sortirent du pays que nous habitons avec une multitude immense de peuple; qu'ils s'établirent en Italie, et que ceux de Vannes y fondèrent la ville de Venise. — Quoi qu'il en soit de ces émigrations, il paraît certain que l'endroit où se trouve Lomariaquer était au- .../... ————— (1) Cette opinion, qui a eu beaucoup de sectateurs, a été combattue par des savants respectables. (Voy. Vannes.). (Note de la 1ère édition). ————— .../... -trefois fort peuplé. On y trouve des monuments qui ne laissent aucun lieu d'en douter. Le fameux Romain qui soumit, pour la première fois, les Gaules à une puissance étrangère se vit obligé de réunir toutes ses forces contre les Vannetais, qui passaient pour très-puissants tant sur mer que sur terre. Il leur livra en personne un combat naval, et les vainquit. Leur ville fut prise et détruite par les troupes romaines. Il y a auprès de ce bourg une fort bonne rade, où l'on dit que ce conquérant fit entrer ses vaisseaux pendant le siège. Au sud-est est une butte d'environ soixante pieds de haut, laquelle se termine en cône. Au nord-ouest, on voit encore une autre butte, qui n'est pas tout-à-fait si élevée ni si large que la première. On prétend que César les avait fait élever pour battre le château que les Vannetais, ou Vénètes, avaient dans l'endroit. Elles sont faites de pierres entassées les unes sur les autres, et de terres rapportées : on les nomme Buttes de César. Dans les environs du village du Hellu, on voit une petite chambre d'environ douze pieds en carré et de quatre pieds de haut, laquelle est couverte d'une seule pierre; les murs en sont faits de pierres carrées, placées debout. Entre le village de Kerpentier et la butte qui est au sud-est, on voit un petit bras de me rappelé en breton Porhe en taille (sans doute Porz-en-Tal, port du fond), c'est-à-dire port de la taille; et vers le septentrion, on remarque la pointe du Hasard, où l'on croit que César avait fait mettre pied à,terre à son armée. Au couchant du bourg se trouve la chapelle de Saint-Michel, qui appartenait jadis à la paroisse, et qui est aujourd'hui à M. le président de Robien, qui l'a achetée, et y a fait mettre ses armes après l'avoir fait rebâtir à neuf. Cette chapelle est sur une élévation et forme un beau point de vue, duquel on découvre, du côté du midi et du couchant, Carnac, Plouarnel, Quiberon, Belle-Ile-en-Mer, les îles d'Houat et de Hoedic, et sur l'Océan aussi loin que la vue peut s'étendre; du côté du levant, on aperçoit l'abbaye de Saint Gildas de Rhuis, le pays d'Arzon et de et Sarzeau, l'Île-aux-Moines, etc. — Au couchant de la même chapelle, on voit encore un mur subsistant, bâti de pierres et de plâtre, lequel répond à un autre mur de mêmes matériaux, découvert sous terre à quatre-vingts pas de là : celui-ci paraît se terminer à un troisième qui a sa direction vers l'orient. — Au devant de la chapelle, on a trouvé en creusant, il y a deux ans, trois autres murs distants de douze pieds l'un de l'autre, bâtis de pierres et de plâtre, avec une grande quantité de tuiles que leur trop long séjour en terre a rendues molles et faciles à briser. On a découvert, dans le même lieu, une cheminée d'environ vingt pieds : elle a la forme d'une pyramide, et la noirceur des pierres, à demi-brûlées, qui sont placées intérieurement, prouve qu'on y a fait jadis du feu. Auprès de ces pyramides sont plusieurs masures on l'on voyait, il y a cinq ans, une autre pyramide renversée par terre : elle était rompue et brisée, et personne ne se souvient de l'avoir vue debout. Il paraît qu'elle était aussi destinée à faire une cheminée, puisqu'elle était creusée intérieurement; mais l`ouverture n'en était pas plus grande que celle d'un canon ordinaire. En 1750, quelques habitants qui faisaient bâtir des maisons au nord de ce bourg trouvèrent, en creusant, une statue de Vénus, en or, d'environ un pouce et demi de hauteur. Les propriétaires en firent présent à M. de Robien, qui les récompensa. On dit que ce seigneur conserve soigneusement cette statue, et qu'il la fait voir à tous ses amis (1). On trouva, dans le même lieu, des murs, des colonnes faites avec des tuiles et de mauvaises pierres noires, mais si bien mastiquées avec du plâtre, qu'on ne pouvait en arracher un morceau sans les briser. Dans une lande située à l'occident du bourg sont plusieurs pierres d'une énorme grosseur, entre autres une de dix-neuf pieds de longueur, sur douze de largeur et cinq à six d'épaisseur; elle est soutenue de trois autres, qui sont debout, en forme de trépied; on y en voit une autre qui est brisée en plusieurs morceaux, et qui paraît avoir eu près de quarante pieds dans toute sa longueur. On croit que ces pierres, et un grand nombre d'autres qui se trouvent dans le même lieu, étaient des autels que les Romains avaient érigés pour offrir leurs sacrifices. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que, dans toutes les carrières du pays, on n'en trouve point de pareilles. — Dans un champ qui est au couchant de la chapelle de Saint-Michel on trouva, en 1771, les fondements d'une maison, dont on distinguait facilement la cheminée; on y trouva aussi un grillage de fer, mais qui, rongé par la rouille, ne pouvait plus servir à rien. Outre ces antiquités, on a trouve dans les environs de ce bourg plusieurs pièces et lingots d'or, les unes sans inscription et les autres sous le nom de César. En 1749, on trouva, en creusant les fondements de la chapelle de Saint-Michel, plusieurs petits pots de terre cuite, lesquels étaient remplis d'une petite monnaie de la grandeur d'un denier, avec l'effigie de Jules-César d'un côté et son nom de l`autre. Il y avait de l'or mêlé dans la composition de cette monnaie, qui était aussi brillante que si elle venait d`être frappée. — Ces découvertes doivent intéresser les curieux, et les engager à faire des tentatives qui nous donneraient sans doute des notions plus certaines de ce qu'était autrefois Lomariaquer. — En 1548, .../... ————— ————— .../... une flotte anglaise de vingt-quatre vaisseaux de ligne et de douze frégates pilla les îles de Houat, de Hoedic et le bourg de Lomariaquer. La majeure partie des maisons fut brûlée, et l'ennemi emporta tout ce qu'il trouva de meilleur, outre 60,000 livres en vin. Il n'y eut qu'un navire français qui se présenta devant cette flotte pour la défense de son pays. Il combattit une journée entière et une partie du lendemain, et fut pris sur le soir; il était de la paroisse de Poldavi. — En 1420, on voyait dans ce territoire le manoir de Rezené, au sieur de Keraër; la baronnie de ce nom a une haute-justice; le fief du Duc, situé dans cette paroisse, en dépend. — Le manoir de Kerderian appartenait dans le même temps à Eon de Coet-Consout. — Ce territoire est pour ainsi dire environné de la mer, et en outre arrosé des eaux de la rivière d'Auray, au milieu de laquelle sont des îles non habitées : telles sont les deux nommées Luhernic (sans doute de Lugherni, briller, avoir de l'éclat], qui se joignent lorsque la mer est basse; le Grand-Besit, le Petit-Besit, le Radenec, le Runiau, le Sehinis, Gavrené et l'Ile-Longue. [Voy. Iles du Morbihan.] Cette dernière, qui est la plus considérable, peut avoir une demi-lieue de circonférence. Au midi du bourg est l'île de Méaband, dont les Anglais s'emparèrent pendant le siège de Belle-Ile. Le mot de Méaband est breton, et signifie qu'ils étaient à se promener (ou plutôt de l'observation). La tradition veut qu'on étende cette dénomination aux vaisseaux de César, qui se retiraient ordinairement auprès de cette île. — Les terres de Lomariaquer sont très-bien cultivées et fertiles en grains de toute espèce. ------------------- * Marteville & Varin (1843) : LOCMARIAKER; commune formée de
l'anc. par. de ce nom; aujourd'hui succursale; contrôle et recette des
douanes; syndicat des gens de mer. — Limit. : N. rivière d'Acronq;
E. Océan; S. anse de Quepan, rivière de Crac'h; O. rivière d'Auray,
Crac'h. — Princip. vill. : Kerpenhir, Keréré, En-Hellut, Kerlud,
Kerhelle, Keriaval, Loperc'h, Kerlevarec, Kerguelvan, Kerinis,
Kerdrean, Kernevcllic, Saint-Philibert, sur l'anse de ce nom, garantie des vents de sud-ouest par la
pointe Er-Bellec; Kercadoret, Coët-er-Rouis, Kernevert (une ancienne tour qui sert
d'amer pour entrer dans le bras de mer de la Trinité'). — Superf. tot.
1804 hect. 67 a., dont les princip. divis. sont : ter. lab. 913; prés et
pât. 283; marais 55; jard. potagers 30; mares et étangs 33; landes et
incultes 436; sables et falaises 14; sup. des prop. bât. 17; cont. non imp. 23. Moulins 2, à vent, dans le bourg
même.
Locmariakaër possède plusieurs restes de monuments romains et celtiques. Ils ont fait supposer que le bourg actuel recouvrait l'emplacement de l'ancienne ville de Dariorigum; toujours est-il qu'une ville importante, soit que sa fondation remonte aux Vénètes, soit qu'elle ait été construite par les Romains, a jadis existé en ce même lieu. M. Gaillard, dans ses savantes Recherches sur Locmariakaër, détermine ainsi les anciennes limites de cette ville : «En partant, dit-il, du carré de maçonnerie situé auprès de la chapelle Saint-Michel, et se dirigeant vers le nord, on remarque partout dans le sol des mégalithes formant de petites courbes en différents sens, et aboutissant aux ruines d'un cirque. Ici les indices cessent; mais au-delà, de rares fragments de briques et de ciment éparpillés pourraient donner à penser que l'enceinte ne se prolongeait pas de ce coté, et qu'une partie des murs du cirque en faisait partie. S'il en était ainsi, elle devait passer sur la voie romaine qui se trouve au-dessous, et gagner le rivage de la mer, en suivant la direction tracée aujourd'hui par des fossés de clôture larges et élevés. ›› En examinant le côté opposé, les mêmes indices se retrouvent; ainsi, revenant au carré de maçonnerie dont M. Gaillard a parlé, et où la tradition place l'emplacement d'un château gothique bâti sur les ruines d'une ancienne forteresse, on remarque d'abord, dans la partie la plus élevée de ce carré, deux murs construits parallèlement, et se dirigeant vers le midi; en suivant le prolongement du second de ces murs, on retrouve dans les clôtures de deux petits courtils des indices de la suite de ce mur; mais de l'autre côté du chemin, après avoir traversé une aire à battre, le mur se présente dans une assez grande largeur hors de terre, bien conservé, et suivant toujours la même direction. A l'extrémité du pâtis auquel il sert de clôture, il semble s'arrêter; le placement des pierres indique un angle, et cependant on le voit se prolonger plus loin. Ce pan de mur est une preuve que la ville était cernée. Il parait bien démontré que l'enceinte se prolongeait jusqu'à la hauteur de cette dernière muraille. Une maison construite au-dessous, sur les bords du quai, a sa fondation assise sur d'anciennes maçonneries. Tout porte à croire que le tracé désigné par M. Gaillard, jusqu'au chemin situé au midi du bourg, comprenant une étendue de 600 mètres de longueur, sur une largeur moyenne de 220 mètres, présente le véritable périmètre de la ville ancienne. Tout cet espace est couvert de nombreuses ruines. Les briques rougissent les terres arables : l'intérieur du bourg offre des inégalités de terrain produites par des amas de décombres et par d'anciennes constructions. En 1840, un paysan a mis à découvert un pan de muraille romaine qui semblait construite de la veille, tant le ciment et les pierres carrées du revêtement avaient conservé sous terre une couleur blanche et neuve. Les briques romaines à rebord et à crochet, qui jonchaient autrefois le sol, étaient innombrables; aujourd'hui elles sont en moins grand nombre. En 1822 ou 1823, lors de la construction à Lorient du grand bassin de radoub, l'ingénieur des ponts et chaussées chargé des travaux maritimes a fait venir de Locmariakaër plusieurs chargements de ces débris de briques. La situation avantageuse de Locmariakaër, à l'extrémité d'une presqu'île, au fond d'une haie spacieuse commandant l'embouchure du golfe du Morbihan et l'entrée des bras de mer de Vannes et d'Auray, doit faire attribuer la fondation de cette ville aux peuples de la Vénétie; elle devait être une de leurs principales cités. Le voisinage des nombreux et gigantesques monuments druidiques qui l'entourent vient corroborer cette opinion. Il parait également positif qu'après la conquête de la péninsule armoricaine, les Romains y ont établi une station. L'inspection des lieux, le sol jonché de briques, les clôtures environnant le bourg, composées de petites pierres uniformément taillées et de même dimension que celles employées par es Romains dans la construction des anciennes murailles, dont quelques portions existent encore, tout parait prouver le séjour des légions dans cette importante position. Et à en juger par le nombre prodigieux de ces pierres de revêtement, les constructions devaient être considérables. On reconnaît dans le Nordrett la courbe bien apparente d'un cirque. Les spectateurs placés sur les gradins pouvaient apercevoir le Morbihan, dont les rivages et les nombreuses îles. alors couvertes de bois, offraient une admirable décoration pour le fond de la scène. Des portions des murs du cirque existaient encore en 1820. On a reconnu les restes d'une voie romaine se dirigeant vers la pointe de Kerisper, où les débris d'un pont romain entravent parfois la navigation de la rivière d'Auray. Auprès de la chapelle Saint-Michel, à l'endroit nommé er-Hastel, où d'importantes ruines romaines furent détruites par les garde-côtes en 1809, on a découvert des canaux souterrains conduisant à la mer, et une fontaine ou citerne romaine qui depuis a été recomblée. Er-Hastel, en langue bretonne, signifie le château. D'après la tradition, une forteresse gothique y fut élevée sur l'emplacement de la ville celto-romaine. Dans toute l'étendue de la commune, et dans toutes les directions, on trouve des tumulus, des grottes aux fées, des dolmens, des menhirs. Ils couvraient autrefois toute la contrée : brisés et renversés par les passants, ils ont successivement disparu du sol. A Carnac, les monuments druidiques, alignés dans un ordre symétrique, occupent une plus grande étendue de terrain; à Ardeven, ils sont plus nombreux. Mais à Locmariakaër, ils sont plus étonnants et plus gigantesques. Ils prouvent l'importance de cette ville vénète, qui, voisine de Carnac, devait être un des grands centres de la religion des Celtes. Le grand peulven et les principaux dolmens et menhirs ont été apportés de fort loin. Ils sont d'un granit étranger à la localité; le grain en est plus gros et d'une couleur différente. A 1 kilom. du bourg de Locmariakaër, vers le sud, s'élève le tumulus Mané-er-H'rouich ( montagne de la Fée ). Quelques voyageurs l'ont faussement appelé butte de César, nom ignoré dans la contrée. Ce galgal peut avoir quarante pieds d'élévation, et contenir environ trois mille quatre cents pieds cubes, composés en totalité de petites pierres. Les habitants du pays viennent y chercher des matériaux de construction. L'on y jouit d'une vue fort belle, et qui s'étend sur une partie des îles du golfe du Morbihan, sur l'Océan, Quiberon, Hoat, Hœdic, Belle-Île et l'île de Rhuys. Au pied du versant est de ce galgal se trouvent deux
menhirs renversés connus sous le nom de men Manné er-Hrouich; le plus grand a 9
mètres de long, le plus petit Men-Melein (la pierre jaune) est un peulven de 3 mètres 40 centimètres, situé à la pointe de Gouémonenn, dans le voisinage de Kerpenhir. Dans le même champ, entre la pointe Gouémonenn et celle de Beg-en-Treah, existe une double rangée de menhirs renversés nommée Men-Letonnic. Cette avenue druidique fait face à l'embouchure du Morbihan, qui regarde le sud-ouest. Sur la pointe er-Vertî, au bord de l'Océan, se trouve la grotte aux fées de Men-Platt. Sa direction est nord et sud. Sa longueur totale est de 23 mètres; elle est composée de onze tables qui reposent encore sur leurs supports. La première a 4 mètres 30 centimètres de longueur sur 2 mètres de largeur; les autres 3 et 4 mètres de largeur sur 1 mètre 40 centimètres. On chercherait vainement sur les pierres de cette grotte aux fées des caractères ou des signes druidiques semblables a ceux de l'île Gaor-Inis. Dans le village de Kerlad, on remarque l'énorme dolmen de Roh'-Guerlud. Sa forme est presque ronde; il a 5 mètres de long sur 4 de large. Sur les bords de l'Océan, en face 1'ile de Meaban, à la pointe er-Honrer, on rencontre un dolmen solitaire. Sur le rivage de la baie de Saint-Philibert, entre le village de Keraulay et de Locpereck, s'élève un beau dolmen nommé Men-er-Vil. La lande de Kerdanicl est couverte de débris de monuments druidiques en partie détruits. Dans le voisinage du village de Kercadoret-le-Gal, on en rencontre également plusieurs. Dans le nord du bourg, auprès du village du Hellut, et non loin de la voie romaine qui conduisait à l'ancienne cité de Locmariakaër, s'élève le barrow de Mamé-Hellut, de forme conique allongée. Il est composé à la surface de terre et de pierre mélangées, et dans l'intérieur de terre seulement, qui prend à une certaine profondeur une teinte blanchâtre et cendrée. Ce barrow domine l'entrée de la rivière d'Auray. A la base de son versant ouest existe un dolmen de grande dimension nommé Er-Havr-en-Hellat. Sa table a 8 m. 60 centim. de longueur sur 5 m. de largeur. Entre ce montissel et le dolmen de Dolvearc'hant s'étend du nord au sud une colline tumulaire peu élevée, d'une forme allongée, et couverte d'ajoncs. Elle est entièrement composée de cendre mélangée de restes de charbon et de débris d'ossements à demi consumés. Bientôt elle disparaîtra du sol, les paysans ayant l'habitude de se servir de cette cendre pour faire leur lessive. Ils l'emploient aussi comme engrais. Il a fallu un bien grand nombre de victimes immolées à la divinité des Celtes pour parvenir à réunir un amas de cendre si considérable. Cette colline, autrefois de 200 m. d'étendue, prouverait à elle seule l'importance de cette localité à l'époque du druidisme. Le plus remarquable et le plus curieux dolmen de Locmariakaër est celui nommé Mein-en-Ritual, au nord-ouest du bourg. Il est suivi d'une grotte aux fées. Cette énorme table de pierre a 17 m. de long sur 4 m. 30 c. de large. Son épaisseur est de 50 c. Elle est ornée en dessous de caractères druidiques. Ce magnifique dolmen, qui était encore debout en 1810, a été renversé et brisé en deux par les garde-cotes. Non loin de là se trouvent les débris d'un petit dolmen en partie recouvert par des pierres extraites des terrains voisins. Au nord, au pignon de la maison du Bronzo, existe le menhir renversé de Men-er-Bronzo. Sa forme est à peu près ronde. Il est aminci aux deux extrémités. Sa longueur est de 8 m. Sur une élévation, au nord du cirque, s'élève le dolmen de Dol-ve-ar-C'hant (la table du marchand), de 6 m. 38 c. de long sur 5 m. 34 de large. Il est suivi d'une grotte aux fées. Des figures semblables à celles du monument de l'île de Gavrinis ont été gravées sur les pierres des supports. A la surface intérieure de la table, on distingue la forme bien apparente d'un celtæ attache a un manche. Ce celtæ a été pris à tort par plusieurs touristes pour un phallus. Plus au nord se trouve un autre petit dolmen nommé la Petite Table du Marchand, Dol-ve-ar-C'hant-Bihan. Un peu vers le couchant, on aperçoit renversé et brisé en quatre morceaux le célèbre peulven de Men-er-Groah (la Pierre de la Fée). La tradition rapporte qu'il a été abattu parla foudre. Ce menhir, le plus grand de tous ceux connus, avait 21 m. de hauteur. On estime le poids de cet obélisque monolithe à plus de 200,000 kilog. Il serait facile de le relever en y faisant entrer de forts pitons de fer ou de cuivre, et en le liant ensuite avec des cercles de fer. M. Gaillard a découvert, près du village de Lannerbrit, sur le rivage de la baie de Saint-Philibert, un ancien monument qu'un antiquaire druidique appellerait un témenn. D'après sa description, il consiste en un grand carré formé par des fossés de terre en rejet, de la hauteur de 7 à 8 pieds. Chaque coté a environ 200 m, de longueur. Il est situé sur le bord de la baie, dans un terrain bas et plat. Les eaux de la mer peuvent y entrer. La surface inférieure est plane, et n'a été rendue inégale dans quelques endroits que par des dépôts successifs favorisés par des touffes de joncs. Dans un champ voisin s'élève un menhir de 10 pieds, et tout auprès les restes d'une tombelle en partie détruite. L'île de Meaban, dépendante de la commune d'Arzon, parait avoir autrefois fait partie de la presqu'île de Locmariakaër, à laquelle elle se trouve réunie par une suite de rochers. Cette plage est encore connue sous le nom de Creuh-er-Mols (refuge des sangliers ). On y a découvert plusieurs troncs d'arbres. Lors de la création de la Compagnie des Indes, il fut question de bâtir à Locmariakaër la ville de Lorient. Cette position était des plus avantageuses. Les navires, contrariés par les vents et les courants pour entrer dans le golfe du Morbihan, auraient pu chercher un refuge dans la baie de la Trinité, limite ouest de la commune, où l'on trouve de 15 à 20 pieds d'eau à la basse-mer. — Il y a aujourd'hui à Locmariakaër quarante à quarante-deux navires caboteurs. — Géologie : constitution granitique. — On parle le breton du dialecte de Vannes. Amédée de Francheville
——————- —————— .../... rapporte la mort de l'évêque Henri Bloc, le XI avant les calendes d'avril 1286, il est dit qu'il donna 20 sous aux chanoines sur la terre de Keraër. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, t. Il, p. xxxiii; Cat. des liv. de Vannes.) Il existe dans cette partie trois paroisses du nom de Locmaria, parce qu'elles sont dédiées à Notre-Dame, situées à peu de distance l'une de l'autre, surtout par mer. Pour les distinguer, on les a surnommées du nom de la seigneurie ou fief supérieur duquel elles dépendaient. L'une est Locmaria-Arzon, située sur la pointe orientale de l'entrée du Morbihan, dans la presqu'île de Rhuys; la seigneurie d'Arzon appartenait à l'abbaye de Redon, dont elle formait un prieuré, et lui avait donnée en 878 par le duc Alain, dit le Grand, alors comte de Bro-Erech, c'est-à-dire de Vannes. (Dom Morice, Act. de Bretagne, t. L) Dans l'acte, elle est nommée Arddon-Rowis, pour Arzon de Rhuys. (Voy. Particle Arzon.) La seconde est Locmaria-Kaër, contracté de Keraër, son ancien nom, et celui de la baronnie de Keraër on Kaër, dont elle dépendait. Cette paroisse est située sur la pointe occidentale de l'entrée du Morbihan, à une lieue en ligne directe de Locmaria-Arzon. La troisième est Locmaria-Quiberon, situé sur la presqu'île de ce nom et distante par mer de trois lieues trois quarts de Locmaria-Kaër. (V. l'article Quiberon.) De B. ------------------- * Editions Delattre (2004) : "probablement l'ancienne capitale des Vénètes". - En 1874, un raz-de-marée qui dévasta la ville. |
![]()
| Patrimoine.
Archéologie / Glad. Arkeologiezh : seules les fenêtres ouvertes ont des liens actifs
|
![]()
ii
Adolphe Joanne. 1886
Gustave Geffroy. 1905 |
|
i
Le grand menhir brisé (Wikipedia) |
![]()
| Étymologie / Gerdarzh : - Ogée (vers 1780) : pas de proposition. * Marteville & Varin (1843) : Locmariaker, orthographe actuelle, n'est pas le vrai nom; c'est Loc-Maria-Kaër, lieu de la belle Marie. "...Locmariakaër possède plusieurs restes de monuments romains et celtiques. Ils ont fait supposer que le bourg actuel recouvrait l'emplacement de l'ancienne ville de Dariorigum; toujours est-il qu'une ville importante, ..." "Loc-Maria-Kaër, ou Loc-Maria-de-la-Ville, ou plutôt Loc-Maria-Kaë, pour Kaër, parce que cette paroisse dépendait de la baronnie de Keraër, ou Kaër, comme l'écrivent les modernes depuis le XIVè siècle (l). Kaër est écrit Kerer dans l'ancienne réformation de 1448, Kerer et Keraër dans celle de 1536, et Kerden en 1421. Keraër, en breton, signifie ville du serpent, ..." * Dauzat et Rostaing (1963-1978) : Chaer, 856; Loc Maria Kaer, 1082; * Jean-Yves Le Moing (1990) : pas d'entrée. * Erwan Vallerie (1995) : Chaer plebs, 856; Caer, 859; Loc Maria Kaer, 1082; Sanctae Maria de Caer; Kaer, 1387; Ker,1452; Locmaria, 1457; parrochia de Kaer, 1470; Loumariaker, 1548; Locmaria en Ker, 1572; Lomaria K., 1630; Lomaria Ker, 1636; Lomariaquer, 1779; * Éditions Flohic (2000) : " loc signifie lieu, Maria, Marie, et kaër, beau. On a donc beau lieu de Marie; ou bien le nom vient de Loc-Kaër qui veut dire pays de Kaër. * Hervé Abalain (2000) : Plebs Caer au IXè siècle; Villa Sae Mariae de Caer au XIè siècle; Locus Mariae de Ker en 14909; il s'agit d'une paroisse ancienne, Kaer; Locmaria, le bourg paroissial, et venu s'ajouter plus tardivement; Caer figurait sous le nom de Chaer plebs, en 856, et désignait un lieu fortifié. * Éditions Delattre (2004) : "Étymologiquement, et afin de distinguer ce Locmaria des autres de Bretagne, on a ajouté le nom de Caër à Locmaria, Caër (ou Kaër) étant le nom de la famille noble possédant la plupart des terres du lieu". * Jean-Yves Le Moing (2007) : p. 150 : "Locmariaquer, à l'entrée du golfe du Morbihan, répond à ce sens de ville, où un établissement religieux du nom de Locmaria "le lieu saint de Marie", a été implanté au XIè siècle au bourg important de Caer, ainsi noté en 959" |
![]()
| Personnages historiques | Tud brudet |
| Nel
ELEC
laboureur; émigré; a participé au débarquement raté des royalistes à Quiberon en 1795; capturé, il est condamné à Auray, le Ier fructidor An III / mardi 18 août 1795, à l'âge de 35 ans. |
Nel
ELEC
labourer; divroet; en eus kemeret perzh ouzh dilestradeg c'hwitet ar roueelerien e Kiberen e 1795; bet tapet; eo bet kondaonet en Alre, ar In fructidor An IIII / Meurzh 18 Eost 1795, oajet a 35 bloaz. |
| Francis Joyon
navigateur record du tour du monde à la voile en solo en 2004 |
Francis Joyon
moraer rekord tro ar bed dre lien dre e-unan e 2004 |
![]()
Armorial * Ardamezeg
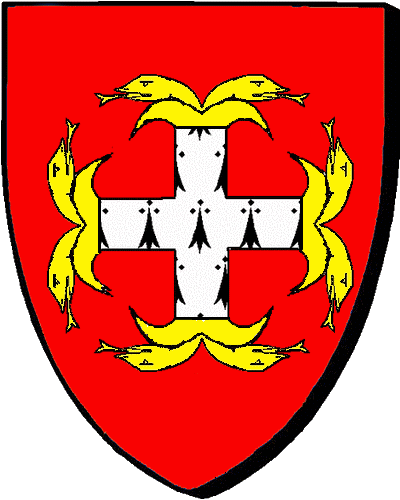 |
||||
| de Keraër, ou de Kaër | ||||
| Seigneurs dudit lieu en Locmariaquer; du
Plessis en Crac'h; de Kerambourg, en Landaul; de Roguedas,
en Arradon "de gueules à le croix d'hermines, ancrée et gringolée d'or" "en gwad, e groaz en erminoù eoriet ha divnaeret en aour" devise / ger ardamez Pour loyauté maintenir 1287; 1240 (PPC) |
![]()
| Vie associative | Buhez dre ar gevredadoù |
![]()
![]()
| Communes limitrophes de Locmariaquer | Kumunioù tro-war-dro Lokmaria-Kaer |
| Saint-Philibert | Crac'h | Golfe du Morbihan | Océan Atlantique |
![]()
| Sources; Bibliographie / Eien; Levrlennadur
: * Ogée : Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne; vers 1780; * MM. A. Marteville et P. Varin, continuateurs et correcteurs d'Ogée en 1843. * Adolphe JOANNE : Géographie du Morbihan. Hachette. 1888. * Albert DAUZAT & Charles ROSTAING : Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France. Larousse, 1963; Guénégaud, 1978. * Éditions ALBIN-MICHEL : Dictionnaire Meyrat. Dictionnaire national des communes de France. 1970. * Jean-Yves LE MOING : Les noms de lieux bretons de Haute Bretagne. Coop Breizh. 1990. * Erwan VALLERIE : Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez * Corpus * Traité de toponymie historique de la Bretagne. An Here. 1995. * Éditions Le Flohic : Le patrimoine des communes du Morbihan; 1996. * Michel FROGER et Michel PRESSENSE. Armorial des communes du Morbihan. Froger SA. 1999. * Hervé Abalain : Les noms de lieux bretons. Universels Gisserot. 2000. * Daniel DELATTRE : Le Morbihan; les 261 communes. Éditions Delattre. 2004. * Jean-Yves LE MOING : Noms de lieux de Bretagne. Christine Bonneton Éditeur. Mai 2007. |
![]()
Liens électroniques des autres sites traitant de Locmariaquer / Lokmaria-Kaer : * lien communal : (1) Facebook * Wikipedia brezhonek : https://br.wikipedia.org/wiki/Lokmaria-Kaer * forum du site Marikavel : Academia Celtica * Autres pages de l'encyclopédie Marikavel.org pouvant être liées à la présente : http://marikavel.org/heraldique/bretagne-familles/accueil.htm http://marikavel.org/broceliande/broceliande.htm * solidarité nationale bretonne avec le département de Loire Atlantique : Loire-Atlantique * sauf indication contraire, l'ensemble des blasons figurant sur cette page ont été dessinés pat J.C Even, sur bases de GenHerald 5. * Introduction musicale de cette page : Bro Goz Ma Zadoù, hymne national breton, au lien direct : http://limaillet.free.fr/MP3s/BroGoz.mp3 hast buan, ma mignonig, karantez vras
am eus evidout go fast, my little friend, I love you very much |
![]()